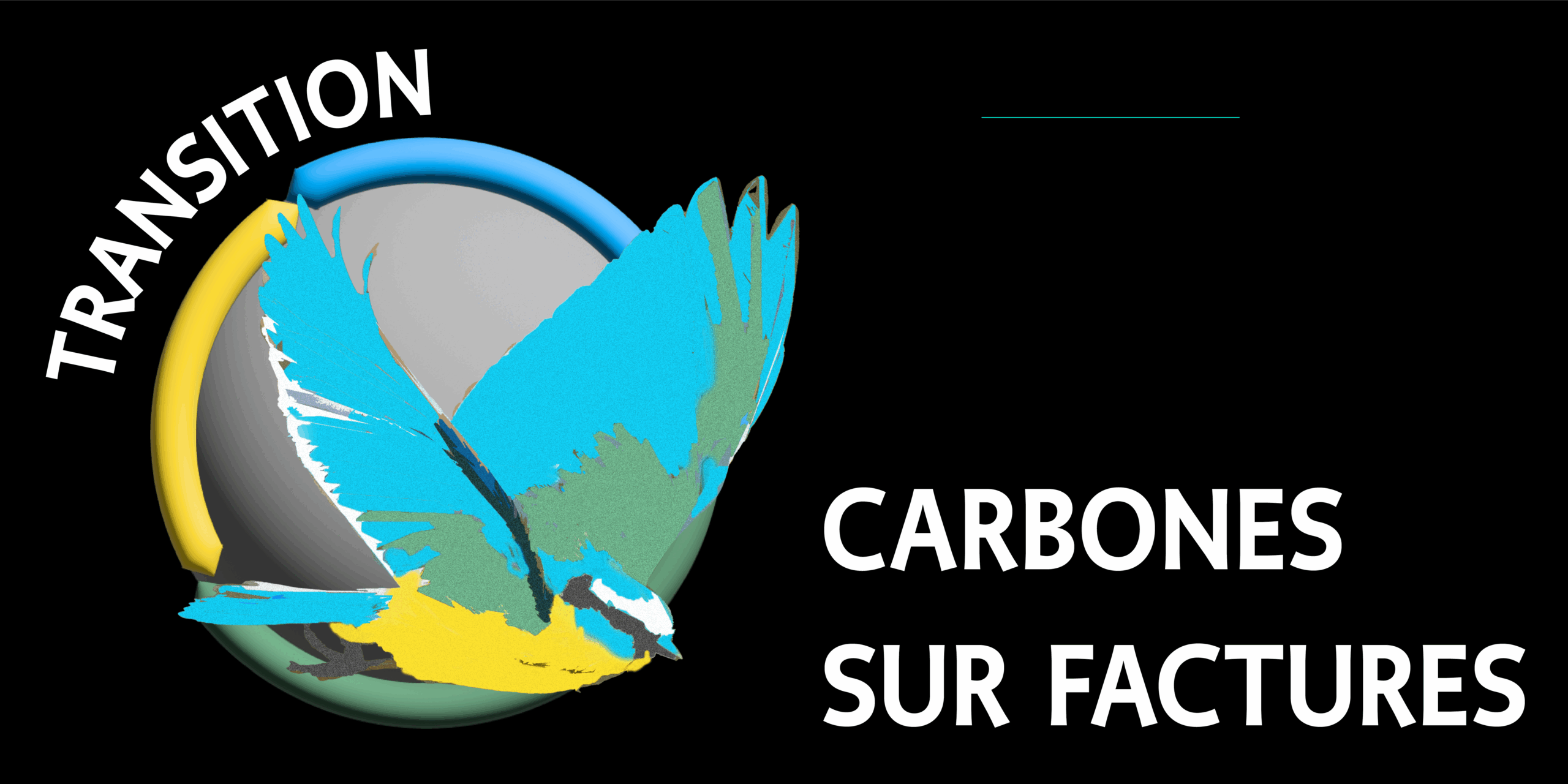Je suis une collectivité locale
je participe à Label Transmission
Label Transmission est un dispositif volontaire, décentralisé, collaboratif et international qui regroupe les acteurs publics et privés respectant la première bonne pratique de la transition :
Le producteur transmet au client le contenu carbone de ses produits
Une collectivité territoriale, ville, communauté de commune, département, région, a vocation à être au cœur du dispositif, comme client et producteur exemplaire de son territoire.
C’est très simple, il suffit d’une déclaration de participation avec les quelques principes assurant une mesure des impacts carbone comparable et rigoureuse, car assise sur les quantités des comptes, simple à calculer et à vérifier.
Cette page décrit :
1- Les avantages à participer pour la collectivité et son territoire
1. L’avantage de Label Transmission pour une collectivité et son territoire
Pour une autorité locale française (ville, communauté de commune, département, région) participer à Label Transmission est consensuel et budgétairement avantageux.
Consensuel, parce que le processus est volontaire et valorisant pour les entreprises ; et qu’il correspond à une demande ancienne des citoyens de connaître le contenu carbone des produits qu’ils achètent ou des services dont ils bénéficient. La demande a tourné court deux fois, faute d’outils simples : au Grenelle de l’Environnement et à la Convention citoyenne pour le Climat dont c’était la première recommandation. L’outil simple est là, avec le Label Transmission.
Budgétairement avantageux, car en devenant plus carbone-efficace dans toutes ses décisions, la collectivité réduit le coût budgétaire de sa transition et de celle de son territoire à court et à long terme.
Il n’y a pas de risque pour une collectivité à s’engager en précurseur sur cette approche qui s’appuie sur des outils internationaux, pour partie récents (les comptabilités carbone cumulatives d’entreprises*) pour partie anciens (les comptabilités carbone nationales, lancées par les Nations Unies en 2012), et qui articulent les deux standards internationaux incontournables (standard carbone et standard comptable) tout en étant compatible avec toutes leurs différentes variantes.
2. Le canevas de déclaration de participation
1- La collectivité signataire tient compte dans ses décisions d’achat de biens ou services de leur Contenu Carbone Produit calculé de façon rigoureuse et comparable. Elle facilite ce calcul pour ses petits fournisseurs et les petites entreprises de son territoire.
2- Au fur et à mesure du déploiement du dispositif dans ses activités, la collectivité transmet à ses administrés le Contenu Carbone Produit des biens et services qu’elle met à leur disposition sur tous les documents indiquant leur coût de revient.
3- Le contenu transmis pour un service est tiré de façon rigoureuse et comparable du dernier compte carbone de production annuel tenu par la collectivité pour l’activité correspondant à ce service. Le compte suit les principes communs aux Comptabilités carbones cumulatives (annexe 1). Le Compte est établi dans les 6 mois suivant la clôture des comptes annuels ‘argent’ de la collectivité.
4- La collectivité encourage les autres autorités publiques territoriales en France et à l’étranger à généraliser le dispositif et à aboutir rapidement à des labels avec reconnaissances réciproques facilitant les vérifications.
5- La collectivité fait ses meilleurs efforts pour respecter les termes de cette déclaration.
Sur 1-
Les marchés publics sont la façon la plus logique de valoriser la bonne pratique de Transmission. Mais d’autres leviers existent dans beaucoup de collectivités conduisant des actions économiques.
Des outils gratuits (tutoriels, et calculateurs-traducteurs) permettent à la majorité des PME et TPE de respecter le processus label Transmission en une heure seulement de tenue de compte par an. La collectivité peut les diriger vers ces outils, ou une collectivité importante peut aisément s’approprier ces outils et les déployer directement.
Sur 2-
Le dispositif est progressif et fonctionne par grande activité. La collectivité peut donc avancer par étape en sachant que sa démarche est cohérente, intuitive pour ses services, que dès la première activité elle dispose de contenus carbone rigoureux et comparables.
La communication est simple et valorisante : si une activité est déjà couverte, la collectivité a à la fois le coût du service et son contenu carbone, sur les mêmes bases comptables. Elle peut expliquer facilement l’évolution de l’un ou de l’autre, et suivre ses progrès dans la même métrique que la trajectoire nationale carbone.
Sur 3-
Les outils gratuits et libres indiqués en 1- de formation, tutoriels, calculateurs… pour déployer le processus sont aussi disponibles pour les collectivités publiques. Une petite collectivité peut les utiliser, une grande peut les répliquer (et les améliorer).
Sur 4-
-La coopération locale est forte, et elle est même obligée dans le cadre des intercommunalités. Une méthode commune autour de mesures rigoureuses et comparables est un immense avantage.
-L’appel aux autorités locales est aussi transmis aux autres autorités territoriales et une collectivité peut facilement le relayer : pour les autorités nationales, et pour les autorités européennes.
Le Contenu Carbone Produit est la quantité totale d’équivalents carbone de gaz à effet de serre émise dans l’ensemble de la chaîne de production du bien ou du service : soit par des émissions directes de l’organisation, soit par le Contenu Carbone Produit de ses intrants. Il ne contient pas d’estimation des émissions provoquées ensuite (leur décompte précis est à la charge de l’étape ultérieure concernée).
Le nom Contenu Carbone du Produit (Product Carbon Content) et sa définition sont inspirés des travaux du professeur Ulf Von Kalckreuth. Il fédère de nombreuses appellations dont les définitions sont équivalentes : émissions intégrées du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union Européenne, e-passifs de l’E-liability Institute, empreinte carbone des groupes de produits dans les matrices Entrées-Sorties, émissions des Analyses du cycle de vie « de la mine au client », émissions des scopes 1, 2 et 3 amont des protocoles carbone (GHG Protocol, Bilan Carbone, …).
La notion de Comptabilités Carbone Cumulatives (Cumulative Carbon Accountings) et leurs principes sont inspirés : des travaux du professeur Ulf Von Kalckreuth ; de ceux des professeurs Robert Kaplan (Harvard Business school) et Karthik Ramanna (Oxford University), inventeurs de la première comptabilité carbone cumulative (E-liability ledger) ; des autres comptabilités carbone cumulatives (Comptabilité collaborative des Shifters, Comptes carbone Produit et Financement de Carbones sur factures …).