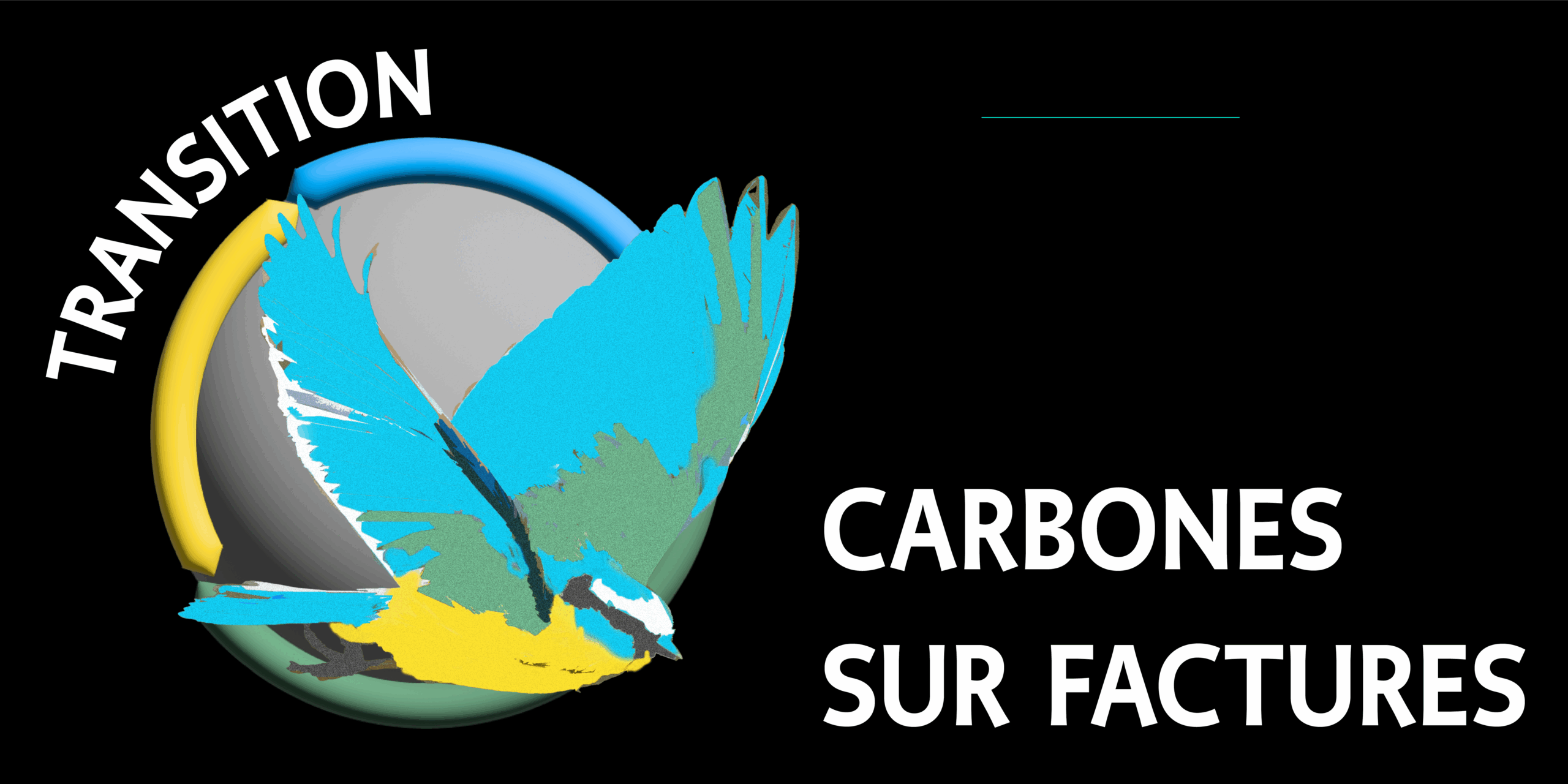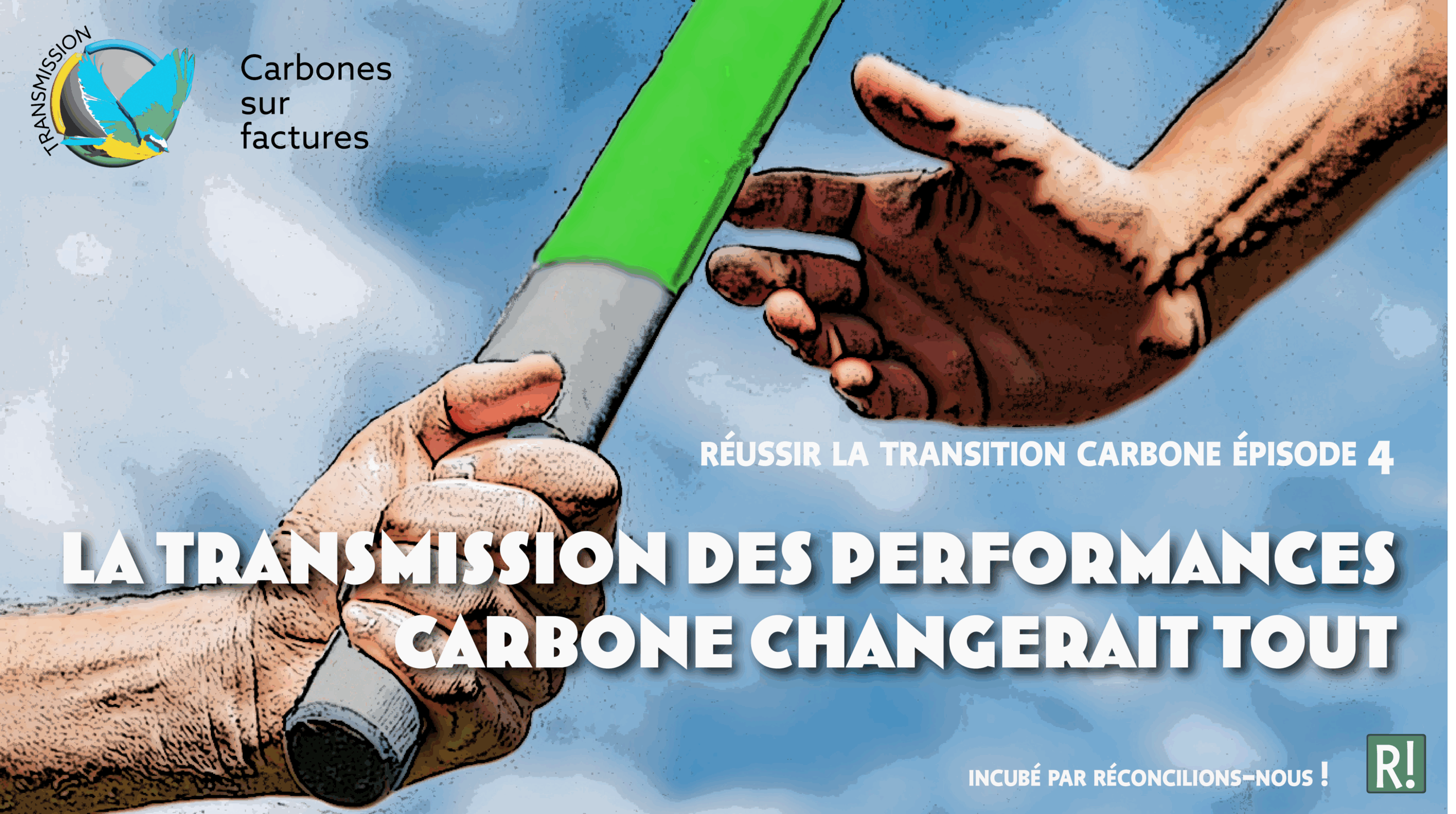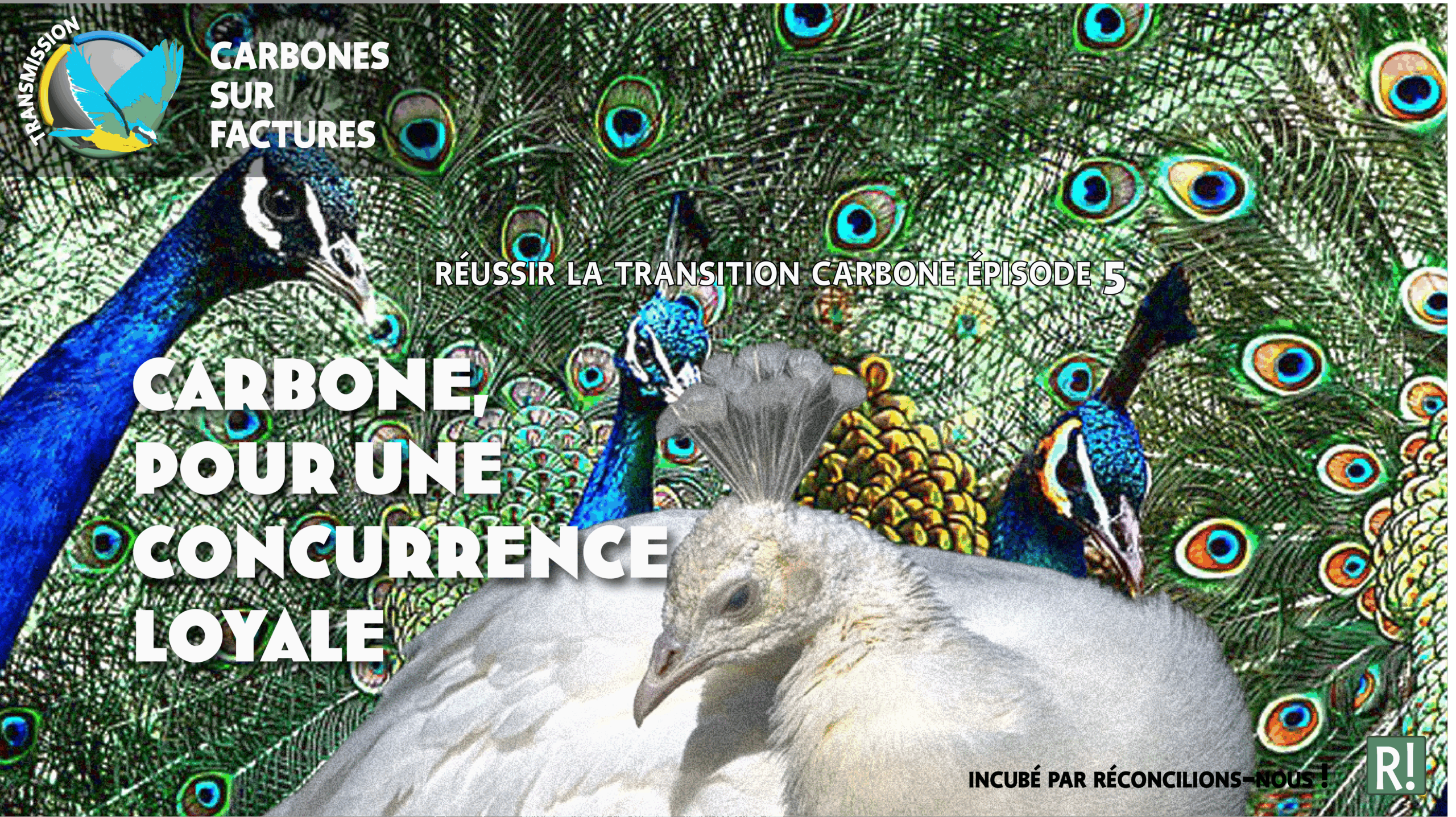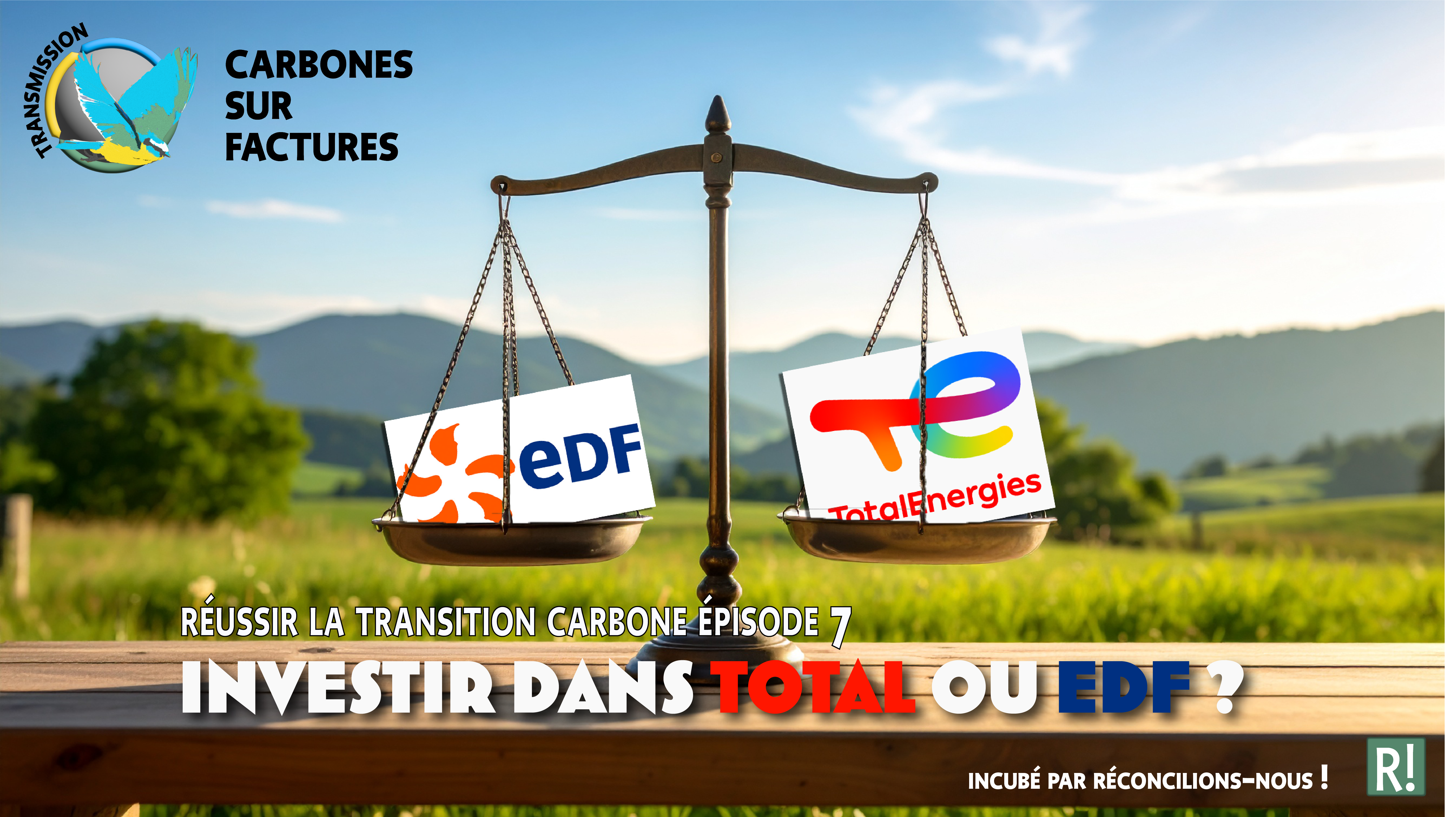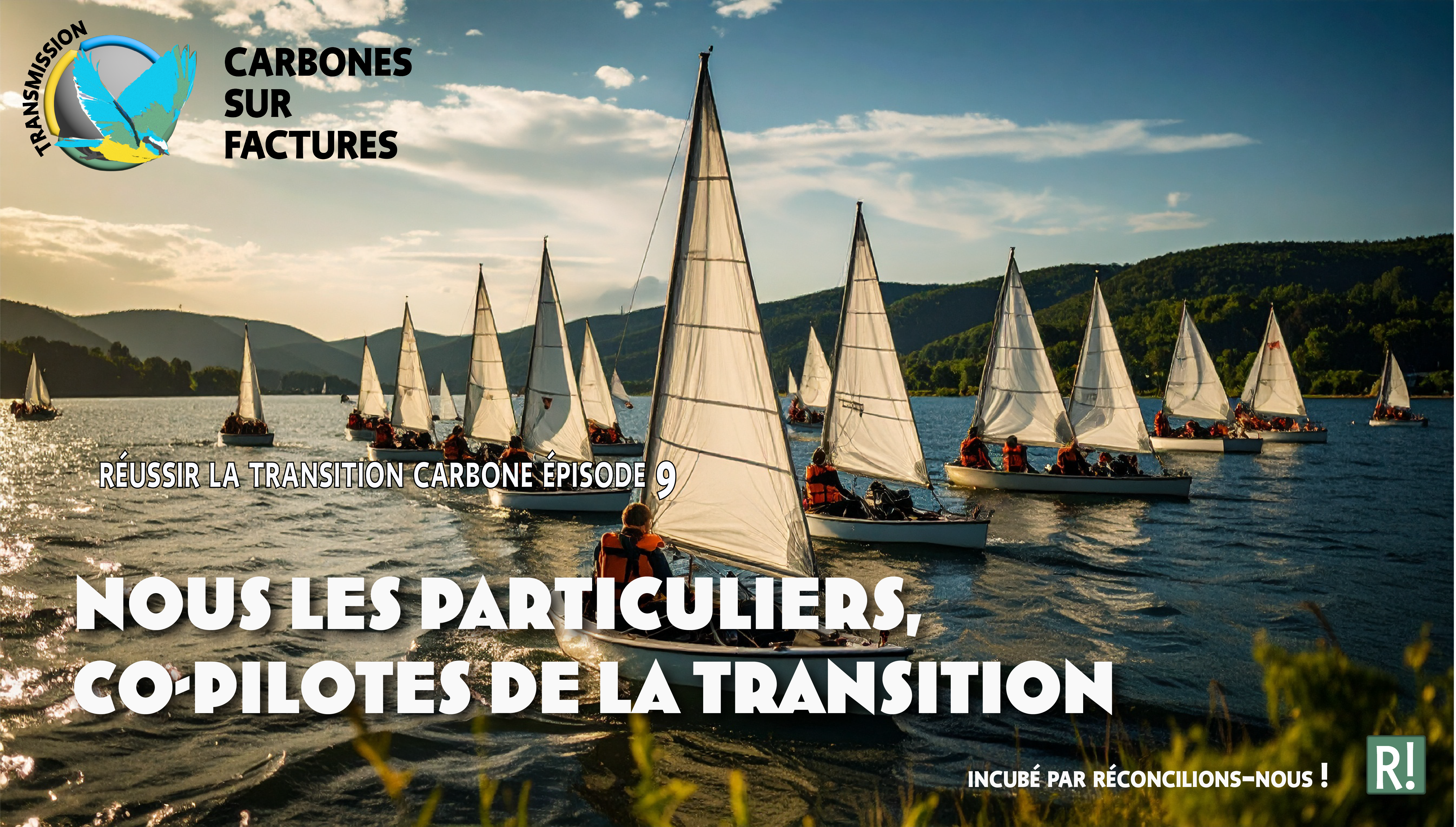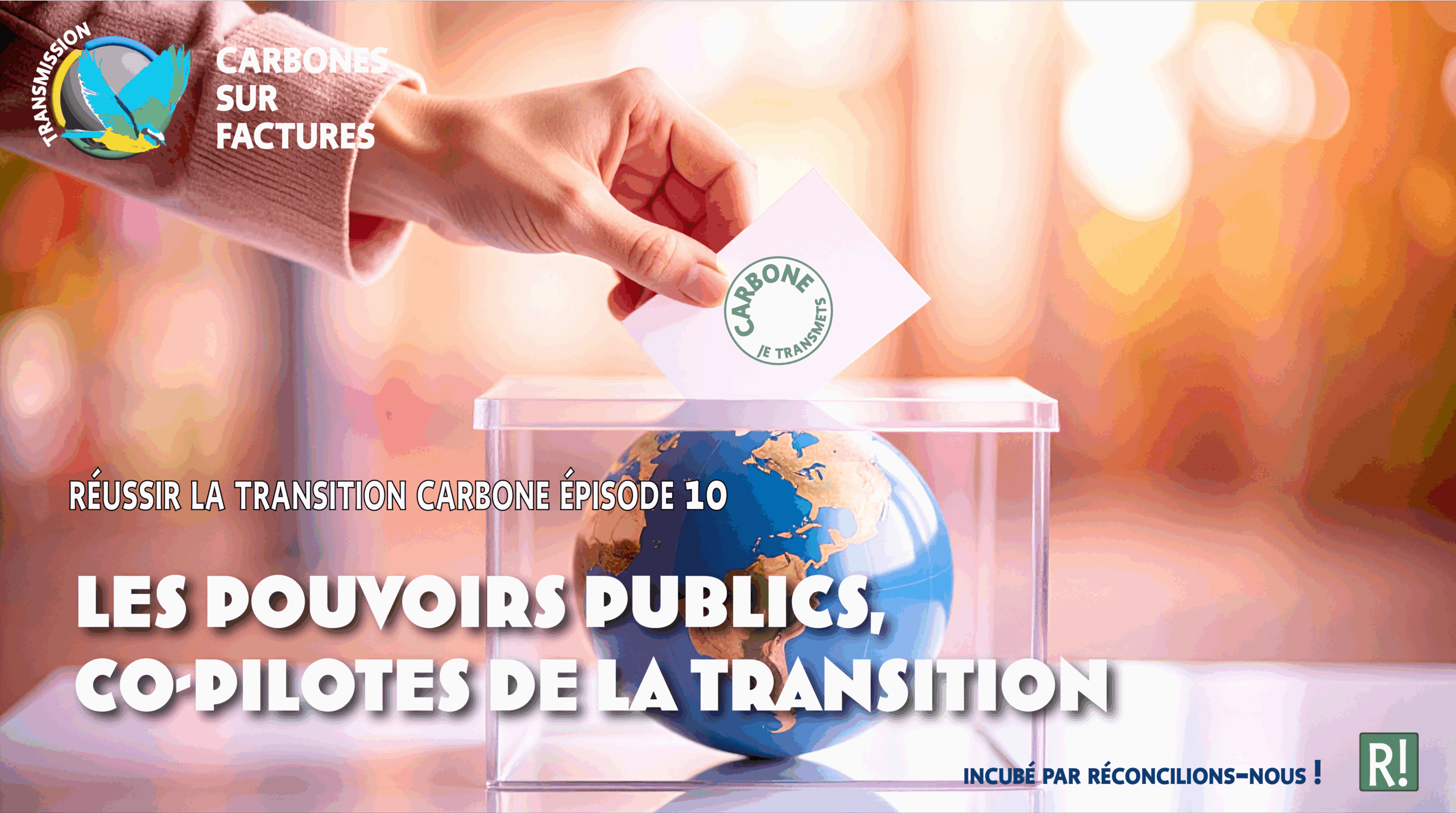Réussir la transition carbone
Une série en 10 épisodes
La destruction provoquée par l’excédent de gaz à effet de serre (ou ‘carbone’) dans l’atmosphère s’accélère. Et au bout, le risque d’une ‘dernière génération’ confrontée à des choix désespérés.
L’économie carbone associe à chaque décision économique, personnelle ou professionnelle, son impact quantitatif sur le flux de carbone vers l’atmosphère, pour équilibrer la décision entre argent et carbone. Et d’abord les achats avec le contenu carbone.
Les décisions d’investissement peuvent aussi être équilibrées entre argent et carbone par leur valeur carbone : pour un projet de production, une organisation, un produit financier. C’est la somme de leurs résultats carbone.
La transmission du contenu carbone d’un bien ou d’un service sur les factures, de la valeur et du résultat carbone sur l’information financière, libère les choix des clients et valorise la qualité carbone des fournisseurs.
Le contenu carbone déclenche une concurrence carbone loyale entre biens et services qui pousse librement vers le bas leur contenu carbone.
En fixant la valeur carbone du temps pour calculer la valeur carbone des investissements, l’humanité se donne sa vitesse minimale de transition : le taux de résultat carbone annuel que doivent dégager ses investissements, et pas seulement les « verts ».
Les gros producteurs, et en priorité ceux d’énergie, doivent calculer et transmettre leur résultat et leur valeur carbone à leurs financiers, puis leurs financiers la transmettre aux particuliers sur leurs produits financiers.
L’Économie carbone intègre les captures du vivant à l’économie et l’impact des activités humaines sur le vivant. Elle illustre qu’Homo sapiens a partie liée avec une grande partie des espèces qui l’ont accompagné et qu’équilibre du climat et de la biodiversité sont un seul et même objectif.
L’Économie carbone nous donne, à nous particuliers, des leviers puissants : la concurrence carbone, pour pointer produits et placements ‘carbone-efficaces’, avec un peu d’attention comme seul coût ; nos performances collectives de consommateurs, pour piloter nous-mêmes les quantités que nous utilisons.
Dernier épisode de Réussir la transition. Après avoir éclairé les priorités des producteurs, des financiers et des particuliers, il donne celles des pouvoirs publics : pour la concurrence carbone avec le label Transmission, faire rentrer dans les comptes publics la biodiversité et une mesure carbone universelle du temps, et tirer de l’économie carbone les compromis politiques qui réussiront la transition à temps.
Episode 1 – Pourquoi faut-il réussir la transition carbone ?
Un phénomène qui détruit le vivant
Les scientifiques constatent un excédent de gaz à effet de serre (GES ou ‘carbone’) dans l’atmosphère. Ils constatent que cet excédent a un pouvoir destructeur sur le vivant à travers divers dérèglements, notamment le dérèglement du climat.
Ils décrivent l’ampleur de ce pouvoir destructeur de l’excès de carbone, sans équivalent avec d’autres poisons que l’homme répand en produisant ou en consommant. Le carbone est en effet dans tous nos produits et dans tous nos projets (le phénomène antérieur le plus proche, les gaz détruisant la couche d’ozone, concernait une infime partie de l’activité humaine).
L’accélération des destructions
Les scientifiques décrivent aussi l’accélération du pouvoir destructeur de cet excès de carbone. Il a fallu huit générations de croissance carbonée pour que les scientifiques les plus vigilants identifient le problème, puis deux générations seulement pour que toute l’humanité le constate. Les scientifiques expliquent bien cette accélération.
Deux accélérations sont dues à l’homme et l’homme peut apprendre à les piloter :
– L’artificialisation des sols ou les plastiques dans l’océan détruisent le vivant et accélèrent l’effet destructeur par moins de captures naturelles des surfaces terrestres ou marines.
– Les efforts humains pour s’adapter à l’effet destructeur (l’air conditionné, les digues…) accélèrent l’effet destructeur en augmentant les émissions.
Deux autres accélérations sont plus menaçantes car extérieures à l’homme : elles naissent de l’effet destructeur lui-même, comme un feu se nourrit lui-même.
– Les échecs des espèces vivantes à s’adapter accélèrent l’effet destructeur en réduisant les captures naturelles de carbone dans l’atmosphère (affaiblissement des arbres…).
– Le franchissement de seuils (encore très mal estimés) de l’excédent carbone risque d’accélérer l’effet destructeur de façon irréversible (fonte du permafrost, modifications de courant marin…).
Le temps joue contre l’humanité
On a donc une certitude scientifique : l’augmentation de l’effet destructeur sera pire pour chaque génération par rapport à la précédente, jusqu’à un nouvel équilibre. Le cri d’alarme des scientifiques face à l’accélération de l’effet destructeur exprime également une inquiétude de bon sens envers ce qu’on peut appeler la ‘dernière génération’ : dernière de celles qui auront tiré avantage du carbone, avant un nouvel équilibre ; ou dernière génération tout court, parce qu’elle héritera de choix entre des solutions désespérées. Pour prendre une image plus riante : notre espèce humaine est le lièvre d’une course avec une tortue tueuse qui accélère. La morale n’est plus celle de la fable : partir « à temps » ; mais de partir tout de suite « à la bonne vitesse » pour ne pas perdre (nous reviendrons à l’épisode 6 sur cette bonne vitesse).
La lenteur de la tortue, paradoxalement, n’est pas un avantage. Comment mobiliser suffisamment toute la planète plusieurs générations d’affilée sur une catastrophe lente mais mortelle ? Il existe heureusement une promesse. La présenter est l’objet de cette série.
Episode 2 – La promesse de l’économie carbone
Les raisonnements en argent ne suffiront pas à piloter la transition
Deux indicateurs en argent coordonnent aujourd’hui toutes les décisions économiques : les prix pour les achats de biens et service et les résultats (ou les valeurs, somme des résultats) pour les financements de projets de production, d’organisations ou de produits financiers. Malheureusement, ils n’arriveront jamais à éclairer seuls les décisions de la transition :
– Deux produits de même prix peuvent avoir des contenus carbone très différents.
– Deux financements peuvent dégager le même résultat en argent avec des résultats carbone très différents.
On ne pilotera pas le défi planétaire collectif que représente la transition sans partager des indicateurs d’efficacité et de résultat carbone : aussi bien pour l’entreprise que pour la banque ou l’administration, des indicateurs partagés du chef d’état au particulier.
Notre proposition : des indicateurs de contenu carbone et de résultat carbone
Comme il est hors de question d’abandonner les indicateurs en argent (sauf à renoncer à la division du travail), la transition impose d’éclairer tous les choix économiques avec un indicateur carbone, jumeau de l’indicateur ‘argent’. L’Economie carbone donne facilement ces indicateurs performances de performance jumeaux en comptant le carbone comme l’économie compte l’argent. Elle transpose simplement en carbone la boite à outils de l’économie, de la finance, de la gestion et d’abord de la comptabilité, qu’elle soit nationale, d’entreprise ou financière.
Pour les achats de biens et services, l’économie carbone complète la performance argent, le prix, avec une performance carbone jumelle : le contenu carbone du produit. C’est le cumul des émissions nettes en amont pour produire ce qui est vendu (comme le prix est le cumul des coûts en amont). Cet indicateur est déjà connu sous des noms divers (empreinte, ou émissions cumulées, ou somme des scopes 1, 2 et 3 amont…). L’Economie carbone simplifie et standardise son calcul. Le producteur peut facilement transmettre au client le prix ET le contenu carbone de ce qu’il achète, avec son devis puis avec sa facture. Le détail de la méthode et les calculateurs qui l’appliquent sont présentés dans notre tutoriel ‘optimiser en carbone ses produits‘.
Episode 3 – Valeur carbone, la belle inconnue
LLe défi de la transition est de construire une économie différente, utilisant un minimum de carbone. C’est donc un défi qui se construit aujourd’hui dans le choix des projets financés aujourd’hui.
Ce qui déclenche certains projets ou qui bloque beaucoup d’autres, c’est largement et souvent uniquement l’espoir d’un résultat positif en argent. Celui qui a de l’argent à placer s’intéresse au total des résultats que lui apportera son financement : les économistes appellent « valeur actuelle » ce total des résultats vu d’aujourd’hui. Celui qui a besoin d’argent, par exemple une entreprise, explique à son banquier ou à son actionnaire que son projet a de la valeur et mérite son argent.
Le défi de la transition est donc d’associer à chaque financement deux valeurs, deux séries de résultats, en argent et en carbone : l’investisseur ou l’épargnant peut alors librement arbitrer entre différents financements en conciliant argent et carbone.
Les définitions jumelles des valeurs argent et carbone
La valeur actuelle en argent d’un financement est donc le total de ses résultats annuels, jusqu’à sa dernière année, vu d’aujourd’hui. Pour ramener les résultats futurs à aujourd’hui, le financier utilise un taux d’actualisation qui intègre la valeur ‘argent’ du temps (quel taux je demande ‘en plus’ dans un an pour investir).
L’économie carbone transpose cette définition de l’argent au carbone : elle mesure les résultats carbone du financement (combien il ajoute ou retire de carbone du flux vers l’atmosphère) et applique une valeur ‘carbone’ du temps. Le calcul du résultat carbone est décrit en détail dans notre tutoriel ‘Optimiser en carbone ses financements‘ avec des calculateurs gratuits. Et nous revenons sur la valeur carbone du temps à l’épisode 6.
La valeur carbone permet de classer tous les financements : + 10 tonnes de carbone veut dire que le financement devrait retirer 10 tonnes du flux vers l’atmosphère sur sa durée de vie ; et + 10 tonnes qu’il devrait les ajouter.
La transition éclairée par la valeur carbone
La valeur carbone est la belle invisible : invisible, parce qu’on ne la voit pas encore sur les produits financiers ; et belle parce qu’elle améliorerait toutes les décisions financières.
Avec elle et le résultat carbone, chaque producteur d’un produit financier pourrait transmettre à son client une performance projetée puis une performance réalisée à la fois en argent ET en carbone.
L’épisode précédent soulignait que des choix financiers éclairés étaient impossibles tant qu’on ne pourrait pas choisir le plus performant en carbone, entre deux financements ayant des performances équivalentes en argent. L’économie carbone libère cette information, essentielle pour réussir la transition.
Episode 4 – La force de la transmission
La transmission du contenu carbone d’un bien ou d’un service sur les factures, de la valeur et du résultat carbone sur l’information financière, libère les choix des clients et valorise la qualité des offres. Elle donne aux clients la liberté de choisir et aux producteurs la liberté d’agir.
Les particuliers gagnent la liberté de choisir
L’information supplémentaire transmise laisse chaque particulier libre de ses choix en fonction de ses préférences argent et carbone. Elle lui ouvre une possibilité nouvelle d’agir concrètement sur certaines décisions : « Je privilégie le critère carbone, ‘ça le vaut bien’ ». Il peut agir sur tous ses achats mais aussi sur tous ses placements et donner un coup de pouce à la transition future.
Concentrer l’information carbone (produit ou placement) sur UNE performance fédère les multiples motivations des particuliers face au carbone : pour eux-mêmes, leur famille, les générations suivantes, le reste du vivant et la biodiversité… Faibles ou fortes, ces motivations vont toutes dans le même sens, puisque personne ne choisira la mauvaise performance carbone, à performance argent équivalente.
Les producteurs et les financiers gagnent la liberté d’agir
Le message des particuliers pèsera : producteurs et financiers anticipent ce qu’attendent leurs clients. La transmission de la performance carbone stimule les efforts, et les efforts justifient la transmission
– « A quoi me sert d’être compétitif carbone si personne ne le sait ? »
– « Mon client va s’imaginer le pire si je ne lui dis rien »
La concentration sur UNE performance (respectivement le contenu et la rentabilité carbone), simple à comprendre et à calculer, facilite la vie du producteur ou du financier. Il a enfin une règle du jeu claire et une performance mesurable de ses produits qu’il peut piloter et valoriser. Le risque carbone devient l’opportunité carbone : une qualité universelle, mesurable et dont l’importance par rapport à l’argent augmentera avec l’aggravation continue des destructions carbone.
La transmission des performances carbone pour réussir la transition
Le succès de la transition repose donc sur le déploiement d’une bonne pratique des producteurs et des financiers, la transmission à leur client de la performance carbone de leur offre :
– Le contenu carbone du bien ou du service est transmis à l’acheteur avec le devis ou la facture.
– Le résultat et la valeur carbone du produit financier est transmise à l’investisseur (avec sa brochure d’information d’abord, avec le dividende ou les intérêts ensuite).
Comment en faire une bonne pratique générale ? Le plus rapide est que les autorités publiques valorisent les producteurs et les financiers transparents ‘qui transmettent’ la performance carbone de leurs produits. C’est possible à tous les niveaux et dans tous les pays. Un label Transmission est simple et économique car il apporte au professionnel des avantages à la main de chaque autorité : sur les marchés publics, sur les financements publics, sur la visibilité… On y reviendra (épisode 10).
Episode 5 – Pour une concurrence carbone loyale
Cet épisode montre comment le Contenu carbone des produits (premier indicateur carbone) est le socle du pilotage de la transition.
Le Contenu carbone a la force d’un message simple : entre deux produits équivalents, le moins carboné est le meilleur pour la transition.
Transmettre le Contenu carbone avec les produits, c’est éclairer les milliards d’achats et de ventes qui se réalisent chaque jour, sans rien imposer à personne ; et déclencher ainsi une transition volontaire et une dynamique vertueuse.
Les particuliers et le Contenu carbone des produits
La simplicité du Contenu carbone est appréciable pour les particuliers. Elle fédère sur un seul signal leurs différentes motivations : qualité de vie des proches, des générations suivantes, du vivant, de la biodiversité… Elle leur ouvre une possibilité d’agir selon leurs valeurs -quelles qu’elles soient- de façon concrète et pas seulement symbolique : le consommateur qui préfère un produit moins carboné, à prix et qualité équivalents, envoie aux producteurs un message économique puissant qui remonte les chaines de production et déclenche une concurrence carbone.
Les producteurs et le Contenu carbone
Un indicateur simple facilite aussi la vie du producteur. Pour piloter sa compétitivité environnementale il lui faut une performance carbone produit partagée avec son client. Beaucoup d’indicateurs de performance complexes sont demandés aux entreprises qui ne concernent pas leurs produits. Résultat, 22 millions de PME européennes n’ont aucun indicateur environnemental, et les indicateurs des grandes entreprises ne disent rien de précis à leurs clients sur le contenu carbone de leurs produits. Le Contenu carbone est une qualité facile à calculer (voir notre tutoriel et son calculateur gratuit : Le pilotage carbone de la performance produit). Travailler et transmettre cette qualité est dans l’intérêt du producteur car il sait que la qualité, et donc le Contenu carbone, fait vendre plus, plus cher et plus longtemps.
Les pouvoirs publics et le Contenu carbone
Une transition volontaire peut se mettre en place, une boucle vertueuse qui tire progressivement vers le bas les Contenus carbone des produits. Les pouvoirs publics peuvent facilement et sans coût provoquer ce déploiement.
– Nous avons parlé de la création d’un Label Transmission valorisant les producteurs qui transmettent le Contenu carbone de leurs produits, et leur assurant des avantages : marchés et financements publics, visibilité…
– Les pouvoirs publics peuvent aussi simplifier leurs demandes réglementaires environnementales en les concentrant sur le Contenu carbone produit.
– Ils peuvent rassurer leurs citoyens et leurs producteurs sur la loyauté de la concurrence carbone : en imposant aux importations sans Contenu carbone rigoureux d’être accompagnées d’un indicateur forfaitaire prudent alertant les acheteurs, qui pourra être renforcé par un tarif douanier assis sur la performance carbone.
Le Contenu carbone agit au-delà de la concurrence loyale
La transmission du Contenu carbone et la concurrence carbone ne suffiront pas pour assurer une transition assez rapide. Mais le Contenu carbone a deux autres mérites.
– Les pouvoirs publics peuvent le renforcer sans dépense budgétaire, en signalant les produits les plus lourds et les plus légers pour un même usage ; ou en équilibrant les subventions aux produits les plus efficaces en carbone par des taxes frappant les produits les moins efficaces (comme le bonus malus automobile).
– Le Contenu carbone permet de mesurer la valeur carbone des financements et, à travers eux, de piloter la vitesse de la transition, thème de notre prochain épisode.
Episode 6 – Quelle vitesse pour la transition
Cet épisode éclaire une question obscure (et débattue) : la vitesse à laquelle l’humanité avance dans sa transition. Pour la simplifier, nous ferons comme si l’Humanité avec un H majuscule était une seule personne.
La vitesse de la transition carbone de l’Humanité
L’Humanité produit ce qui est nécessaire à ses besoins immédiats (consommation) et à ses besoins futurs (investissements réclamant des financements : directs dans des projets et des organisations, indirects dans des produits financiers). C’est sur les financements qu’elle compte pour faire face à la menace carbone : construire une production et une consommation « presque » zéro carbone ; et protéger le vivant dont les captures permettent le « presque ».
Le résultat carbone de ses financements est la variation du flux de carbone vers l’atmosphère. Mais quel résultat carbone viser pour les financements décidés aujourd’hui ? L’Économie carbone suggère une réponse scientifique à cette question.
Le taux de rentabilité carbone de l’investissement mondial peut être assimilé à la vitesse de la transition : s’il est négatif, la transition recule ; s’il est positif, la transition avance et d’autant plus vite que le taux projeté est élevé. Pour accélérer sa fortune, il vaut mieux investir à 50% de rentabilité plutôt qu’à 3%. C’est pareil en carbone pour accélérer sa transition.
Ce que nous dit la rentabilité carbone moyenne de l’investissement mondial
Le monde décarboné de demain se fabrique avec l’investissement d’aujourd’hui. L’indicateur de performance « rentabilité carbone mondiale » nous rappelle que le succès ou l’échec de la transition dépend d’une performance financière collective sur la (très longue) durée.
Contrairement à ce qu’on entend, bien suivre 10 ou 20% d’investissements spécifiques marqués « transition » ou « verts » ne pourra jamais donner un résultat moyen convenable. C’est TOUT l’investissement (et donc toute l’épargne) qu’il faut suivre. Les financiers savent que s’ils veulent garantir un taux de rentabilité moyen pour un portefeuille d’investissements, il leur faut un suivi exhaustif, parce que les pertes en argent des investissements non suivis peuvent coûter bien plus que ce que rapportent les gains des investissements suivis.
C’est d’autant plus vrai en carbone : les pertes en argent d’un investissement sont généralement plafonnées à l’argent investi (grâce à des limites de responsabilité de l’investisseur). La perte en carbone sur un investissement peut aller bien au-delà du carbone investi.
La vitesse minimale de la transition
On peut faire dire une autre chose essentielle à cette vitesse de la transition en calculant, non pas la « bonne » vitesse (qui est une décision politique) mais une vitesse minimale : la rentabilité carbone minimale à respecter. Elle peut en effet se déterminer sur des bases scientifiques en fonction notamment de la durée maximale de transition que peut supporter sans drame l’humanité (et le vivant sur lequel elle s’appuie). Cette vitesse minimale transpose simplement en économie carbone la logique des financiers en argent : ils appellent taux d’actualisation le taux de rentabilité minimal au-dessous duquel ils ne financent pas.
Episode 7 – Financer EdF ou Total Energies ?
Suivre la rentabilité carbone en priorité dans l’énergie
L’humanité doit dégager une rentabilité carbone minimale sur la moyenne de ses investissements, et pas seulement pour les investissements « verts » (épisode 6).
Il est logique de commencer par la rentabilité carbone des investissements des gros producteurs d’énergie, l’enjeu n°1 de la transition. Il faut alors qu’un gros producteur d’énergie calcule et transmette à ses financiers sa rentabilité carbone, projetée puis réalisée, c’est-à-dire (épisode 3) son résultat carbone divisé par son investissement carbone. Le producteur d’énergie connait son investissement carbone. L’Economie carbone lui donne son résultat carbone, en partant du résultat carbone collectif des producteurs d’énergie.
Le résultat carbone collectif des producteurs d’énergie
L’Economie carbone applique deux principes :
– Elle clarifie le service rendu (ici l’énergie) avec une unité de mesure commune de sa quantité : l’unité du système universel quand elle existe, donc le joule pour l’énergie. La comptabilité nationale carbone donne combien de carbone il faut en moyenne aux producteurs pour produire une unité : un ‘contenu carbone par joule’ qui est leur compétitivité carbone collective. En France par exemple, il faut environ 50 microgrammes de carbone par joule, moins pour l’électricité (28), plus pour l’essence (70).
– Elle mesure le résultat carbone collectif des producteurs par l’impact sur la transition de la variation d’une année sur l’autre du ‘contenu carbone par joule’ : un bénéfice si leur compétitivité carbone moyenne baisse, une perte si elle augmente.
Le résultat carbone d’un producteur d’énergie en particulier
Chaque producteur d’énergie contribue à ce résultat carbone collectif. Il enregistre un bénéfice s’il réduit le contenu carbone par joule, à hauteur de l’impact sur la transition (et une perte s’il l’augmente). Avec deux façons d’y arriver :
– Améliorer sa propre compétitivité carbone. EdF dégagera un bénéfice carbone par exemple en repoussant la durée de vie d’une centrale ; et Total en réduisant des fuites de méthane et/ou privilégiant les énergies les plus compétitives en carbone.
– Faire varier ses ventes (en joules) : vendre plus si sa compétitivité carbone est meilleure que la moyenne des producteurs, vendre moins si elle est plus mauvaise. Pour augmenter ses ventes ET dégager un résultat carbone positif, Total doit améliorer son contenu carbone par joule (autour de 64) au-dessous des 50 microgrammes de moyenne.
La rentabilité carbone de chaque produit financier
Chaque producteur d’énergie pourrait ainsi demain transmettre sa rentabilité carbone à ses financiers (ou les analystes financiers le calculer pour lui) pour qu’elle arrive jusqu’au particulier, pour l’aider à équilibrer ses choix financiers entre argent et carbone. Les particuliers font massivement confiance aux établissements financiers pour choisir ce que finance leur argent. Ils pourront donc comparer le rendement carbone d’une action Total et d’une obligation EdF mais surtout comparer les rentabilités carbone des comptes courants, des Livrets A, des produits d’Assurance vie, et s’inquiéter des pertes.
Une concurrence carbone financière se mettra alors en place qui poussera progressivement la rentabilité carbone vers le haut et le carbone émis vers le bas.
Episode 8 – La biodiversité, alliée indispensable
L’Economie carbone coordonne la transition en intégrant dans l’économie les captures du vivant, vitales pour l’humanité.
La représentation traditionnelle des captures du vivant est trompeuse
Dans la représentation traditionnelle, l’humanité cherche à mieux produire, consommer, financer, pour arriver le plus vite possible au Net Zéro : un nouvel état stable où les émissions de l’humanité sont compensées par les captures naturelles du reste du vivant (arbres, océans …). Depuis 30 ans, ces captures sont mesurées ‘à côté’ des émissions des activités humaines, comme si elles étaient des choses indépendantes. Aujourd’hui, les travaux des scientifiques contredisent cette représentation.
Les liens réciproques entre activités humaines et captures naturelles
Les captures naturelles dépendent directement ou indirectement de la plupart des activités humaines, à travers l’agriculture, les forêts, la pèche, la chimie, l’artificialisation des sols… Et c’est encore plus vrai dans l’autre sens : l’activité humaine a besoin de captures naturelles suffisantes puisqu’aucune grande activité humaine ne sera Zéro Carbone sans captures naturelles, aussi efficaces que soient les producteurs, aussi sobres que soient les consommateurs.
L’Économie carbone accueille le vivant dans l’économie
L’Economie carbone intègre cette dépendance réciproque en intégrant les captures naturelles du vivant d’un territoire dans la comptabilité carbone de ce territoire (matrices Entrées/Sorties) : sa production de captures naturelles (en tonnes de carbone par km2) avec l’impact des différentes activités humaines sur ces captures, positif ou négatif. Elle peut aussi intégrer les atteintes irréversibles à l’environnement (acidification des océans …). Elle responsabilise ainsi chaque décision humaine sur son impact sur les captures naturelles. C’est la seule façon de conduire une trajectoire des captures naturelles bouclant la transition.
Climat, biodiversité, désertification : une seule transition
L’Économie carbone fait dialoguer climat, biodiversité et désertification (les trois conventions des Nations Unies : GIEC, IPBES et UNCCD). Elle montre que les raisonnements comptables carbone et les intuitions de beaucoup d’humains sur leur communion fusionnelle avec la nature disent la même chose.
Le vivant survivra à la menace carbone : il survit bien au cœur du désert, au fond des abysses ou dans des territoires tellement chauds et humides que l’homme se noie à l’air libre. Mais l’homo sapiens a partie liée avec une grande partie des espèces qui ont accompagné ses 12.000 générations : l’échec de la transition signerait leur disparition commune. L’alliance est vitale, le succès ne peut être que commun.
Episode 9 –Nous les particuliers, co-pilotes de la transition
L’Economie carbone donne aux particuliers des outils puissants pour piloter la transition.
Notre rôle ? Jouer la concurrence carbone, en achetant les meilleurs contenus carbone et en investissant dans les meilleures valeurs carbone. Et piloter nous-mêmes, d’ores et déjà, les quantités que nous utilisons.
Jouer la concurrence carbone
Jouer la concurrence carbone, c’est seulement faire attention aux contenus et aux valeurs carbone des biens, des services et des produits financiers. Cela suffit à déclencher une concurrence carbone qui récompense les producteurs compétitifs carbone et qui déclenche leurs innovations carbone : pour que, par exemple, un mètre carré habitable, une unité d’énergie, ou un kilomètre parcouru contienne de moins en moins de carbone. Le producteur compétitif comprend qu’il peut gagner plus d’argent en jouant la qualité-carbone. Un bel exemple est la fortune réalisée par Elon Musk en anticipant que beaucoup d’américains étaient prêts à payer très cher une voiture au départ peu fonctionnelle pour prouver aux autres qu’ils sont des gens bien.
La concurrence carbone ne coûte aux particuliers qu’un peu d’attention
Une Tesla coûte cher et on en déduit que la concurrence carbone implique des sacrifices financiers pour les particuliers. Ce n’est pas vrai. L’acheteur de Tesla se fait plaisir, il ne fait pas un « sacrifice ». Et on peut enclencher le Zéro carbone à Zéro coût, en privilégiant le produit ou le placement le plus compétitif en carbone à égalité de valeur ‘argent’. (Même si, évidemment la transition avance plus vite si des particuliers acceptent un surcoût en échange d’une meilleure performance carbone.)
Notre première bonne pratique de particulier est donc de demander au producteur l’impact carbone de son produit et d’en tenir compte dans nos choix.
Notre propre pilotage des quantités utilisées
La concurrence carbone oblige les producteurs à innover en continu pour abaisser le contenu carbone de leur produit : réduire le contenu carbone du m2 habitable, du km parcouru ou de l’unité d’énergie. Ils le feront progressivement. Mais ces innovations seront sans impact sur la transition (et l’arrivée au Zéro carbone) si parallèlement les quantités utilisées par habitant (et le nombre d’habitants) augmentent en continu de leur côté.
Notre seconde bonne pratique, en tant que particuliers, est donc de piloter progressivement les quantités que nous utilisons : les biens privés que nous achetons et les services publics que nous finançons par l’impôt.
Un tableau éclairant des progrès collectifs
L’Economie carbone permet de suivre annuellement les progrès sur chaque grand besoin : la maitrise par les producteurs de leur productivité carbone et la maitrise par les consommateurs des quantités. Elle associe par exemple à un grand besoin comme la mobilité, la quantité utilisée par chaque habitant, mesurée en nombre de km parcourus par an : monde entier, par pays … Elle indique aussi la valeur carbone gagnée ou perdue en mobilité par rapport à l’année précédente (une valeur insuffisante si c’est une perte) avec les performances collectives respectives des producteurs et des consommateurs.
Ces performances collectives nous aident à réfléchir à notre responsabilité personnelle : sur nos choix de consommateur et nos décisions de citoyen concernant les services publics et les règles de transition nécessaires.
Episode 10 – Les pouvoirs publics, copilotes de la transition
La concurrence carbone décrite dans les épisodes précédents aidera considérablement les pouvoirs publics. Chaque acteur prend en charge SA transition et fait avancer au passage LA transition. Il reste aux pouvoirs publics à organiser cette concurrence carbone et à y embarquer la biodiversité et la finance. L’Economie carbone aidera aussi les pouvoirs publics à construire des compromis équitables pour réussir la transition ‘à temps’, c’est-à-dire avec une atmosphère encore viable.
Nous proposons quatre messages à relayer au maximum auprès des pouvoirs publics.
Lancez la concurrence carbone avec le label Transmission
Vous, pouvoirs publics, devez déployer la concurrence carbone et vous pouvez le faire à tout niveau territorial de façon gratuite et consensuelle avec label Transmission. Ce dispositif volontaire, décentralisé, collaboratif et international fédère les acteurs publics et privés respectant la première bonne pratique de la transition : le producteur transmet au client l’impact carbone de ses produits. (Nous reviendrons dès la rentrée de septembre sur son lancement, voir le lien ci-dessus).
Avec les comptes nationaux carbone, vous donnerez facilement les résultats collectifs annuels de la transition, par activité et en distinguant le résultat des producteurs et celui des consommateurs (épisode précédent). Vous satisferez ainsi les consommateurs qui souhaitent suivre l’avancement de façon concrète.
Faites rentrer le vivant et la biodiversité dans l’économie
Nous avons aussi vu (épisode 8) que les signaux carbone (par activité, par produit, par financement) doivent intégrer le vivant et la biodiversité. Cela préoccupe énormément de citoyens. Et aucune activité humaine ne peut fonctionner sans captures naturelles, donc sans le vivant et sans la biodiversité. Vous, pouvoirs publics nationaux, pouvez facilement faire entrer le vivant dans la statistique publique carbone. Et vous devez le faire rapidement, en parallèle des autres chantiers, sinon vous risquez de mettre en danger toute la transition. Reprenons la cible donnée par l’ADEME à chacun en France de ramener son carbone annuel de 9 tonnes à 2 tonnes : ces deux tonnes sont censées être absorbées en 2050 par les captures du vivant. L’objectif est vide de sens si on ne s’organise pas en parallèle pour conserver ces 2 tonnes de captures.
Demandez aux scientifiques une valeur carbone universelle du temps
L’Economie carbone peut donner à chaque investissement sa valeur carbone, c’est-à-dire le carbone qu’il retirera ou ajoutera au flux de carbone vers l’atmosphère (épisode 6). Il suffit de s’accorder sur UNE donnée : la valeur carbone universelle du temps ou ‘taux d’actualisation carbone’ en langage économique, assis sur une base scientifique. Il vous revient d’encourager cette recherche, de mettre le suivi de ce taux universel à l’ordre du jour des prochaines COP et de mettre en place un suivi prudentiel des investissements dangereux : ceux dont la valeur carbone est très négative.
Construisez les compromis pour réussir la transition à temps
Reste le plus difficile. L’Economie carbone vous donne l’infrastructure de la transition avec, pour chaque acteur, deux sons de cloche sur chaque décision, aussi rigoureux l’un que l’autre : un résultat argent de l’acteur et un résultat carbone de la collectivité. Chacun prend alors librement de meilleures décisions (d’achats, de production, d’innovation, de financements …) gagnantes pour lui ET pour la collectivité.
Mais souvent une cloche dira l’acteur ‘gagnant’ et la collectivité perdante ou l’inverse : « cette décision est bonne en argent pour toi mais mauvaise en carbone pour la collectivité » ; ou l’inverse : « elle est coûteuse en argent pour toi mais bonne en carbone pour la collectivité ». L’Economie carbone vous aidera à mesurer l’étendue du problème et à construire des transferts ou des réglementations efficaces. Mais ce sera à vous d’inventer les compromis équitables nécessaires. Votre tâche sera indispensable et difficile car certains des intérêts particuliers en cause sont terriblement puissants.
Derniers mots
Merci d’avoir suivi ces épisodes. Ils décrivent une façon de réussir une transition dont chacun est acteur. La présentation est rapide ? Bienvenue pour suivre nos tutoriels et leurs webinaires. Et bienvenue pour aller au-delà, l’Economie carbone est un vaste champ de recherche !
La mauvaise nouvelle est que la transition risque d’être bien plus longue et difficile que ce qu’on fait semblant de croire. La bonne nouvelle est qu’elle reste possible en passant d’un pilotage partiel autour de la valeur argent, à un copilotage général à deux dimensions, l’argent et le carbone. Prenons la transition en main.